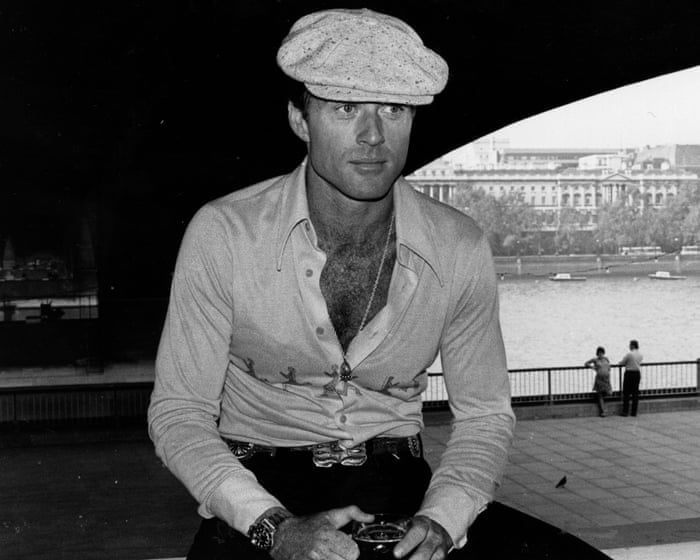George Mitchell, le principal négociateur américain de l'accord de paix en Irlande du Nord, déclara un jour que la diplomatie représente sept cents jours d'échec pour un jour de succès. À Gaza, le drame est qu'il y a eu sept cent trente jours d'échec sans un seul jour de succès. La dévastation, les pertes humaines stupéfiantes et la propagation du conflit à d'autres nations témoignent honteusement de l'échec diplomatique et de l'érosion du droit international. Ceci pourrait bien être l'heure la plus sombre pour la diplomatie depuis 1939.
Certains estiment que l'échec est inévitable, étant donné l'enracinement profond et la résistance au compromis du conflit, suggérant qu'il ne peut être résolu que par la force, via la suppression ou l'élimination d'une des parties.
Pourtant, malgré l'animosité profondément ancrée, un consensus émerge en Occident sur la gestion gravement inadaptée de cette crise. Les dirigeants européens ont initialement confié la responsabilité à une administration démocrate américaine qui idéalisait Israël moderne, a mal évalué la réaction de son gouvernement aux horreurs du 7 octobre, et a sous-estimé la division de l'opinion occidentale qui en résulterait.
Les aveux de faute et les justifications émanent désormais de l'ancienne équipe de Joe Biden. Dans son livre sur sa campagne présidentielle infructueuse, Kamala Harris se souvient : "J'ai exhorté Joe, lorsqu'il s'exprimait publiquement sur ce sujet, à faire preuve de la même empathie pour la souffrance des civils gazaouis innocents que pour les Ukrainiens. Mais il n'a pas pu : alors qu'il pouvait déclarer passionnément 'Je suis un sioniste', ses remarques sur les Palestiniens innocents semblaient insuffisantes et forcées."
Elle ajoute que Benjamin Netanyahu n'a jamais rendu la loyauté que Biden lui a témoignée, lui préférant Donald Trump comme interlocuteur.
Au mieux, les démocrates ont mal jugé les rapports de force. "Nous n'avons pas agi en superpuissance", a déclaré Andrew Miller, ancien secrétaire d'État adjoint pour les affaires israélo-palestiniennes. "Au lieu de partir du principe que nous pouvions résoudre ces problèmes, nous nous sommes convaincus que nous ne pouvions guère influencer notre allié régional, Israël."
Trump ne partageait pas ce sentiment de limitation. Il a utilisé l'imprévisibilité comme principal outil diplomatique, mais comme Biden, son envoyé spécial Steve Witkoff s'est enlisé en tentant de négocier un accord pour libérer tous les otages sans qu'Israël ne reprenne les hostilités, comme en mars.
Alors que diverses versions des propositions de Witkoff émergeaient, la France et l'Arabie saoudite ont agi indépendamment, utilisant une conférence de l'ONU sur la solution à deux États pour orienter la diplomatie dans une nouvelle direction. Cela a brisé le monopole américain sur les efforts de paix et a finalement mis en avant la question longtemps négligée de l'autonomie palestinienne.
Le Plan du 'Jour d'Après'
Avant la conférence—initialement prévue en juin mais reportée d'un mois suite à l'attaque d'Israël contre l'Iran—Emmanuel Macron a obtenu une lettre du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas approuvant un plan post-cessez-le-feu. Selon ce plan, le Hamas serait désarmé et exclu du pouvoir, et un organe transitoire d'experts gouvernerait la Palestine "sous l'égide" d'une Autorité palestinienne réformée. Cette fois, la notion souvent vague de réforme de l'AP a été concrétisée par des étapes, incluant l'engagement d'Abbas à tenir des élections longtemps reportées et à des changements internes, avec le déploiement d'une force internationale.
Plusieurs plans du "jour d'après" pour Gaza circulaient depuis 2024—un par des experts américains et israéliens publié par le Wilson Center, un autre par la Rand Corporation, des principes des Émirats arabes unis, et une proposition égyptienne. Le plan franco-saoudien a intégré nombre de ces idées dans la déclaration de New York, adoptée par la conférence de l'ONU en juillet et ensuite approuvée par l'Assemblée générale de l'ONU.
En septembre, l'Assemblée générale a vu Israël et les États-Unis voter contre une résolution. Un diplomate européen a noté : "Nous avons persuadé les Américains de lier les engagements de cessez-le-feu à un plan post-conflit et de reconnaître que se concentrer uniquement sur un cessez-le-feu ne serait pas efficace."
Concernant la forte dépendance des États-Unis envers la puissance militaire israélienne, le diplomate a ajouté : "Nous les avons aussi convaincus qu'ils ne pouvaient pas continuer à parier et s'attendre à un résultat parfait."
Un moment clé fut une réunion fin août à la Maison Blanche, où Jared Kushner, Tony Blair et Steve Witkoff ont convaincu le président Trump qu'expulser de force les Palestiniens de Gaza n'était ni nécessaire ni sage. Un participant a rapporté : "Trump était conscient de la fiabilité douteuse de Netanyahu et avait investi dans les relations au Moyen-Orient. Il a convenu que des pays comme la Jordanie et l'Égypte n'accepteraient pas un afflux de réfugiés palestiniens, il a donc écarté l'idée d'un déplacement massif."
Un autre résultat fut l'alignement des stratégies américaine et française. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a expliqué à Harvard que Trump avait envoyé des conseillers recueillir des idées auprès des nations arabes, de la France et du Royaume-Uni pour un plan post-conflit. Le but de la conférence et du vote à l'ONU était de dégager la voie vers une solution à deux États, avec des États arabes condamnant les attaques du 7 octobre et acceptant d'exclure le Hamas de l'avenir de Gaza.
Barrot a souligné que le vote marquait la première condamnation internationale du Hamas, le qualifiant d'organisation terroriste et exigeant son désarmement et son exclusion de la gouvernance. Il a aussi noté que les gouvernements arabes s'étaient publiquement engagés à normaliser les relations avec Israël et à former un cadre régional similaire à l'ASEAN ou l'OSCE, des déclarations qu'ils n'avaient jamais faites auparavant.
Contrairement aux apparences, la période précédant l'Assemblée générale a vu les États arabes dialoguer avec Israël, tandis que le Hamas, opposé à la solution à deux États, était marginalisé et a accepté sa perte d'influence politique.
Cependant, Israël a jugé la déclaration de New York inacceptable en raison de son soutien à un État palestinien et à une Autorité palestinienne réformée. Lorsque Trump a présenté son plan alternatif aux États arabes et musulmans pendant l'assemblée, la déclaration a servi de référence pour l'évaluer.
Le plan Trump, largement conçu par Blair et Kushner, était volontairement vague, manquait de détails et omettait un calendrier. Les États arabes avaient des réserves, mais des soutiens comme Blair affirmaient qu'un plan plus détaillé perdrait un large soutien et son élan. Les diplomates occidentaux étaient satisfaits que le plan n'ait pas fuité immédiatement, y voyant le signe que les nations arabes croyaient pouvoir travailler avec.
Alors que les délégations arabes quittaient New York, Netanyahu est resté, tenant de longues réunions le week-end avec Witkoff. Après la frappe israélienne contre des négociateurs du Hamas au Qatar le 9 septembre—considérée comme une trahison personnelle envers Witkoff et le Qatar—Netanyahu n'était plus le bienvenu à la Maison Blanche. Pourtant, il a obtenu des concessions supplémentaires.
L'amnistie pour les membres du Hamas était limitée à ceux qui déposeraient les armes en présence d'observateurs internationaux et s'engageraient à une coexistence pacifique. Plus de détails étaient inclus sur le démantèlement de l'infrastructure du Hamas. De plus, le retrait des Forces de défense israéliennes restait flou, l'IDF ne devant se retirer que dans une zone tampon couvrant plus de 17% de Gaza jusqu'à ce que la zone soit sécurisée contre toute menace terroriste renouvelée.
Dans un message vidéo après la publication du plan, Netanyahu a rassuré ses partisans que les demandes fondamentales d'Israël étaient satisfaites : Gaza resterait séparée de la Cisjordanie, l'Autorité palestinienne ne reviendrait pas à Gaza, il n'y aurait pas d'avancée vers une solution à deux États, et les forces de sécurité israéliennes ne se retireraient pas de la majeure partie de la bande de Gaza.
En satisfaisant les partisans de la ligne dure de sa coalition, Netanyahu tentait aussi de pousser le Hamas à rejeter le plan, lui permettant de poursuivre l'avancée militaire vers Gaza City.
La Réponse du Hamas
Bien que le plan ne précise pas quand le conseil technocratique transférerait le pouvoir à un gouvernement palestinien élu, le Qatar, la Turquie et l'Égypte ont encouragé le Hamas à accepter de nombreux points ambigus, pouvant être résolus plus tard, pour mettre fin à la guerre.
Les diplomates ont noté que ce message a plus résonné avec les jeunes combattants du Hamas à l'intérieur de Gaza, profondément conscients des sacrifices, qu'avec la direction politique à Doha. Avec une formulation suggérée par le Qatar, la réponse du Hamas était essentiellement un "oui" conditionnel ouvert à interprétation. Au grand dam de Netanyahu, Trump l'a interprété comme une acceptation sans équivoque. Surtout, le Hamas était prêt à abandonner son principal atout de négociation : les otages restants.
Selon Tahani Mustafa du Conseil européen des relations étrangères, la politique palestinienne est devenue plus pragmatique depuis l'attaque du 7 octobre. Les Palestiniens cherchent désormais des leaders pouvant rendre la vie tolérable, protéger leurs terres et améliorer les conditions de vie, beaucoup se résignant à leur sort.
Dans ce contexte, l'organe technocratique, présidé par Trump mais probablement dirigé par Blair avec l'apport de figures de la diaspora palestinienne, pourrait gagner en légitimité par son efficacité.
Blair opérera dans un environnement volatil avec des élections approchant en Israël et en Palestine. Un des premiers défis de l'organe sera d'établir des liens avec les factions politiques palestiniennes. Bien que Blair ait de solides connexions avec les élites moyen-orientales, il manque de soutien populaire et pourrait compter sur des pays comme l'Égypte pour médiatiser avec le public.
La Chine mène des pourparlers sur l'unité palestinienne, mais le président vieillissant et autoritaire de l'Autorité palestinienne a tenté de les saper. Si les élections ont lieu comme prévu, elles pourraient amener du changement. Lors de la dernière tentative d'élections en Cisjordanie en 2021, un intérêt démocratique clair était visible, avec 36 listes indépendantes formées en dehors des factions établies. Une préoccupation majeure est ce qui pourrait arriver si les résultats électoraux ne plaisent pas au conseil technocratique de Blair.
Alors que la guerre à Gaza traîne en longueur, causant toujours plus de destruction, la réputation d'Israël a sévèrement souffert. Dans le monde arabe, Israël est désormais perçu comme une plus grande menace sécuritaire que l'Iran. Dans le Sud global, il est comparé à l'Afrique du Sud de l'apartheid, tandis qu'en Europe, les protestations et accusations de génocide persistent. Des majorités croissantes de Juifs américains et de Démocrates désapprouvent aussi les actions d'Israël.
Robert Malley, un négociateur américain pendant les Accords d'Oslo, a récemment co-écrit un livre arguant que les solutions diplomatiques rationnelles au conflit sont impossibles. Il a noté que les médiateurs externes se sont trop concentrés sur le fait d'amener les deux parties à s'accorder sur le concept d'un État palestinien—de simples mots sur le papier—sans aborder la nature plus profonde du conflit. Il l'a décrit comme un "choc historique de récits".
Du point de vue israélien, ils ont été victorieux en 1948 et 1967. Les Palestiniens, quant à eux, estiment avoir subi une injustice historique en 1948, lorsque 700 000 d'entre eux ont été expulsés et ont perdu leurs terres.
Malley a ajouté que pour les Américains de venir et suggérer de masquer ces différences—ignorant le droit au retour et les griefs historiques des deux parties—puis de présenter cela comme la paix n'allait jamais être acceptable pour les parties concernées.
Questions Fréquemment Posées
Bien sûr Voici une liste de FAQ sur les échecs diplomatiques dans le contexte du conflit Israël-Gaza, conçue pour être claire et accessible.
Questions Niveau Débutant
1 Que signifie réellement "mal gérer" le conflit ?
Cela signifie que les efforts diplomatiques des dirigeants mondiaux et des organisations ont échoué à arrêter la violence, protéger les civils ou créer une voie vers une paix durable. Au lieu de cela, les actions ou inactions aggravent souvent la situation.
2 Pourquoi est-il si difficile pour d'autres pays d'intervenir et d'arrêter les combats ?
Le conflit est extrêmement complexe, les deux parties ayant des revendications historiques, religieuses et sécuritaires fortes. Les grandes puissances ont souvent des alliances et intérêts contradictoires, rendant une réponse internationale unifiée presque impossible.
3 Qu'est-ce qu'un cessez-le-feu humanitaire et pourquoi est-il si difficile à obtenir ?
Un cessez-le-feu humanitaire est une pause temporaire des combats spécifiquement pour permettre à l'aide (nourriture, eau, médicaments) d'atteindre les civils. C'est difficile car chaque partie craint que l'autre n'utilise la pause pour gagner un avantage militaire.
4 Comment une diplomatie mal gérée affecte-t-elle les gens ordinaires ?
Cela entraîne plus de morts, des destructions généralisées, une crise humanitaire qui s'aggrave et alimente la haine et la radicalisation des deux côtés, rendant la paix future encore plus difficile.
5 Quel est le rôle des Nations Unies dans ce contexte ?
L'ONU tente de négocier des cessez-le-feu, livrer de l'aide et adopter des résolutions. Cependant, ses efforts sont souvent entravés car les États membres puissants peuvent opposer leur veto aux actions qu'ils désapprouvent.
Questions Avancées / Pratiques
6 Quelle est la différence entre une action unilatérale et une action négociée dans ce contexte ?
Unilatérale : Une partie agit seule sans l'accord de l'autre. Cela escalade souvent les tensions.
Négociée : Les deux parties s'accordent sur des termes via des intermédiaires. C'est plus difficile à obtenir mais c'est l'essence d'une diplomatie réussie.
7 Pouvez-vous donner un exemple de faux pas diplomatique dans ce conflit ?
Un faux pas courant est lorsque des dirigeants ou organisations étrangers émettent des déclarations partiales qui ne condamnent qu'une partie tout en ignorant les actions ou griefs de l'autre. Cela est perçu comme prendre parti, détruit la confiance et les rend inefficaces comme médiateurs neutres.