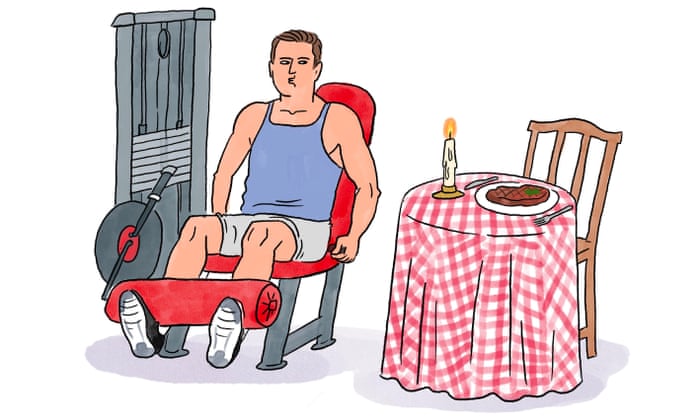En 2015, je conseillais le président polonais sur les défis démographiques du pays : le taux de fécondité était bloqué à 1,3 enfant par femme, l’un des plus bas d’Europe. Je pensais comprendre le problème. La plupart des couples polonais voulaient deux enfants mais n’en avaient finalement qu’un. Les raisons me semblaient évidentes : emplois précaires, manque de modes de garde et logement inabordable. À 27 ans, débordante de l’assurance de la jeunesse et de certitude, je débattais avec des politiciens et décideurs deux fois plus âgés que moi – surtout des hommes – qui affirmaient que des femmes comme moi auraient plus d’enfants si l’État offrait simplement assez d’incitations financières.
Il s’est avéré que nous nous concentrions tous sur le mauvais problème. Au cours de la dernière décennie, le taux de chômage de la Pologne est tombé parmi les plus bas de l’UE. Les revenus ont plus que doublé. Le nombre de places en crèche et en garde d’enfants a considérablement augmenté. Le gouvernement consacre désormais près de 8 % du budget national à des transferts monétaires dans le cadre du programme « 800 Plus », qui verse 800 zlotys par mois et par enfant aux familles.
Pourtant, durant cette même période, la population polonaise a diminué de 1,5 million d’habitants. Un million de nouveaux ménages d’une personne sont apparus dans les registres démographiques, reflétant silencieusement un changement des normes sociales. En 2024, le taux de fécondité est tombé à 1,1, plaçant la Pologne parmi les nations les moins fécondes au monde, aux côtés de l’Ukraine en guerre. Cette année, il devrait encore baisser à 1,05.
Le problème n’est pas seulement que les Polonais ont moins d’enfants. De plus en plus, ils n’ont pas de partenaire avec qui en avoir. La dernière phase des conflits de genre ne fait pas qu’entraver la natalité, elle empêche aussi la formation des couples – entendez ici les unions hétérosexuelles, qui constituent encore la base de la plupart des statistiques de naissances.
À travers la majeure partie de l’histoire humaine, être seul signifiait faire face à la mort. Le mot « solitude » existait à peine en anglais avant l’ère industrielle. Au début du XXe siècle, seul un faible pourcentage d’adultes restaient non mariés – encore moins en Europe de l’Est qu’à l’Ouest. Dans l’actuelle Pologne, seulement 8 % vivaient en célibataires, tandis qu’en Angleterre, ce chiffre était presque le double.
Un siècle plus tard, la situation s’est inversée. Près de la moitié des Polonais de moins de 30 ans sont célibataires, et un cinquième supplémentaire est en couple mais vit séparément. Les sondages montrent que cette génération, surtout les 18-24 ans, se sent plus seule que toute autre – plus encore que les Polonais de plus de 75 ans. En 2024, près de deux jeunes hommes sur cinq déclaraient n’avoir pas eu de relations sexuelles depuis au moins un an. L’abstinence s’est aussi polarisée, les hommes de droite et les femmes de gauche étant les plus susceptibles d’être inactifs sexuellement.
Les jeunes Polonais ne font pas que dormir séparément – ils scrollent séparément. Sept sur dix ont tenté leur chance sur les applications de rencontre. Mais la promesse de choix infinis semble avoir conduit à une hésitation sans fin : seulement 9 % des jeunes couples se sont réellement rencontrés en ligne. Ce qui ressemble à une crise de la natalité dans les statistiques ressemble, dans la vie quotidienne, à une crise de la connexion.
Les conflits de genre, attisés par la polarisation politique, les algorithmes de rencontre biaisés et la tension entre indépendance et intimité, se sont propagés dans une grande partie du monde. Mais dans l’Europe post-communiste, la lutte semble plus intense. Trois facteurs distinguent la région : le rythme vertigineux des changements, l’essor de la psychothérapie comme nouveau langage culturel et l’héritage du communisme lui-même.
Peu de régions ont connu une transformation aussi rapide. Depuis 1990, le PIB par habitant de la Pologne a été multiplié par huit, même après ajustement du coût de la vie. Depuis 2002, le chômage est tombé de 20 % à 2,8 %. La prospérité a remodelé la vie quotidienne et la conscience, bouleversant les schémas de vie traditionnels et déclenchant une réévaluation des rôles de genre.
Les temps qui changent amènent des valeurs qui changent. Ils compliquent aussi la communication entre les générations.
Ma grand-mère, qui a quitté l’école à 10 ans, m’a exhortée à renoncer à étudier à Cambridge de peur que je ne perde mon petit ami. Ma mère, l’une des premières infirmières diplômées de notre ville, m’a encouragée à y aller mais… Elles m’ont mise en garde contre un prêt étudiant britannique, insistant que « c’est mal de vivre endetté » – comme si la dette était une anomalie plutôt qu’une partie fondamentale de l’économie moderne. Pendant ce temps, à Cracovie, à l’autre bout de la Pologne et du spectre social, les parents de mon partenaire – tous deux professeurs érudits – l’ont poussé à se concentrer sur la perfection de son mémoire de master plutôt que de parier sur une entreprise qui pourrait un jour réussir. Pour beaucoup de mes amis, grandir a consisté non pas à apprendre de leurs parents, mais à leur expliquer comment fonctionne le monde.
La famille, autrefois considérée comme le fondement inébranlable de la Pologne, commence à faiblir. Lorsque le mur de Berlin est tombé, moins de 6 % des enfants naissaient hors mariage – près de cinq fois moins qu’en Grande-Bretagne. Mais lorsque cette génération a atteint l’âge adulte, beaucoup ont choisi la distance plutôt que la responsabilité. Si les données sur les ruptures familiales sont incomplètes, les estimations suggèrent que jusqu’à un Polonais sur quatre de moins de 45 ans n’a aucun contact avec son père, et jusqu’à un sur 13 est coupé de sa mère. (En Grande-Bretagne, environ une personne sur cinq a perdu le contact avec un membre de sa famille.) Quand les parents ne montrent plus l’exemple, devenir parent soi-même devient un acte d’improvisation.
Ce que fournissaient autrefois la famille et l’église, la thérapie l’offre désormais. Élevés avec une diète émotionnelle spartiate, de nombreux Polonais se sont tournés vers la psychothérapie. Il y a dix ans, c’était tabou ; aujourd’hui, les services de santé publique rapportent une augmentation de 145 % des consultations psychologiques sur dix ans. Les thérapeutes privés, chez qui la plupart des gens cherchent réellement de l’aide, affichent des taux de croissance qui feraient envie aux capital-risqueurs. Ce changement est autant culturel que clinique : dans les conférences d’affaires glamour, l’orateur principal a autant de chances d’être un expert en relations comme Esther Perel qu’un fondateur milliardaire. Le Parlement débat actuellement de la manière de réglementer ce que les critiques appellent le « far west » de la psychothérapie, où l’introspection profonde se mêle aux coachs de vie à solutions rapides.
Cependant, les 22 % de Polonais qui ont consulté un thérapeute ces cinq dernières années sont surtout jeunes, féminins et célibataires. Ils en ressortent fluent dans un vocabulaire de « self-care », « besoins » et « limites », souvent adressé à des hommes qui parlent encore en termes de « devoirs », « normes » et « attentes ».
Derrière ces luttes personnelles se cache un paradoxe propre à l’Europe post-communiste : elle est à la fois plus et moins égalitaire en matière de genre que l’Ouest. Le communisme, en rejetant le modèle familial bourgeois, a poussé les femmes vers le travail à temps plein et les études supérieures, donnant à la Pologne l’un des plus petits écarts de rémunération entre les sexes de l’UE. Dès les années 1980, les femmes étaient déjà plus nombreuses que les hommes à l’université. Pourtant, dans la vie privée – mariage, tâches ménagères, éducation des enfants – les normes traditionnelles ont persisté. Aujourd’hui, quand les femmes cherchent des partenaires de statut égal ou supérieur, mais obtiennent deux diplômes universitaires sur trois, le calcul ne fonctionne plus.
Hommes et femmes sont aussi géographiquement divisés : la migration interne a biaisé les ratios de sorte que dans les grandes villes comme Varsovie, Łódź et Cracovie, il y a au moins 110 femmes pour 100 hommes. Les hommes sont plus susceptibles de rester dans les petites villes, éloignés de la nouvelle économie et des normes sociales en évolution.
En conséquence, la pénurie de bébés en Pologne n’est pas quelque chose qui peut être résolu avec des incitations financières, des prêts hypothécaires moins chers ou des gardes d’enfants subventionnées. Ce qui vacille, c’est le fondement même de la vie familiale. Le vrai défi n’est pas la volonté d’avoir des enfants, mais la capacité de construire une vie avec quelqu’un. Le succès économique de la Pologne cache ce qu’on pourrait appeler le moment Ingmar Bergman de la nouvelle génération : une crise silencieuse non pas de guerre ou de pauvreté, mais de silence – comment vivre ensemble, comment se connecter, comment maintenir l’intimité dans un pays où les gens sont devenus des experts de l’épanouissement indépendant.
Anna Gromada est maître de conférences à l’Académie polonaise des sciences à Varsovie et conseillère politique pour des organisations internationales.
Avez-vous des réflexions sur les sujets abordés dans cet article ? Si vous souhaitez partager une réponse de 300 mots maximum par e-mail pour une éventuelle publication dans notre rubrique de lettres, veuillez cliquer ici.
Foire Aux Questions
Bien sûr Voici une liste de FAQ sur la chute vertigineuse du taux de natalité en Pologne, basée sur l'analyse selon laquelle les incitations financières ne suffisent pas à contrer un sentiment généralisé de solitude.
Questions Niveau Débutant
1. Que se passe-t-il avec le taux de natalité en Pologne ?
Le taux de natalité en Pologne chute de façon spectaculaire. Pour faire simple, les gens ont beaucoup moins d'enfants qu'auparavant, ce qui signifie que la population vieillit et diminue.
2. Pourquoi un faible taux de natalité est-il un problème pour un pays ?
Un faible taux de natalité signifie qu'à l'avenir, il y aura moins de jeunes qui travaillent et paient des impôts pour soutenir un nombre croissant de retraités. Cela peut peser sur les systèmes de retraite, les soins de santé et l'économie en général.
3. Le gouvernement ne donne-t-il pas de l'argent aux gens pour avoir des enfants ?
Si, le gouvernement polonais a mis en place des programmes financiers comme le "500+" qui verse des allocations mensuelles par enfant. Cependant, ces incitations n'ont pas inversé la tendance à la baisse du taux de natalité.
4. Si ce n'est pas une question d'argent, quelle est la principale raison pour laquelle les gens n'ont pas d'enfants ?
Selon la chercheuse Anna Gromada, une raison clé est un sentiment généralisé de solitude et un manque de systèmes de soutien. Les gens estiment qu'élever un enfant dans la société d'aujourd'hui est un fardeau écrasant qu'ils doivent porter seuls.
Questions Niveau Intermédiaire
5. Quel est le lien entre la solitude et la décision d'avoir un bébé ?
Il s'agit moins d'être seul que de se sentir non soutenu. Les futurs parents s'inquiètent de l'immense responsabilité, des coûts élevés du logement et de l'éducation, et du manque d'aide fiable de la famille ou de la communauté. Ils ont l'impression que c'est trop difficile de tout faire par eux-mêmes.
6. Comment les incitations financières ne parviennent-elles pas à répondre à ce sentiment de solitude ?
L'argent aide à payer les factures, mais il ne crée pas une communauté de soutien, n'aide pas pour la garde d'enfants, ne réduit pas le stress au travail ni ne fournit de réconfort émotionnel. Une allocation gouvernementale ne peut remplacer le coup de main d'un grand-parent, un employeur flexible ou un ami de confiance.
7. Pouvez-vous donner un exemple concret de la manière dont cette solitude se manifeste dans la vie réelle ?
Imaginez un couple où les deux travaillent à plein temps. Ils pourraient calculer qu'après avoir payé une crèche chère et difficile à trouver et géré un travail exigeant, ils n'ont ni le temps, ni l'énergie, ni le "village" nécessaire pour aider à élever un enfant. L'avantage financier ne résout pas leurs difficultés logistiques et émotionnelles quotidiennes.
8. Les jeunes Polonais ne sont-ils tout simplement pas intéressés par fonder une famille ?
Les