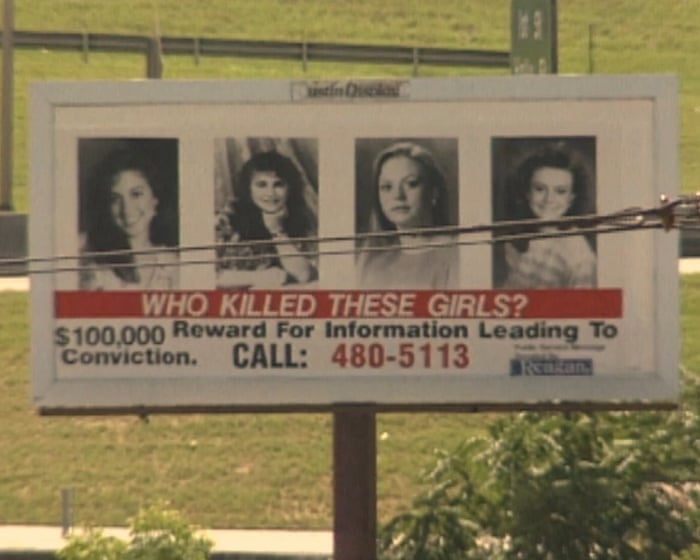En tant que personne ayant toujours été opposée à l’austérité, je trouve la situation de la France déroutante. Le pays affiche une dette nationale de 114 % du PIB et un déficit budgétaire de 5,8 %, et pourtant, malgré des années d’accusations de la part de critiques de gauche comme d’extrême droite selon lesquelles le président Macron a mené des politiques « ultralibérales », les chiffres racontent une autre histoire. Sur le plan macroéconomique, les dépenses publiques de la France (57,3 % du PIB) et ses recettes fiscales (51,4 % du PIB) figurent parmi les plus élevées au monde, y compris des dépenses sociales qui dépassent celles de tous ses voisins européens.
Dans le même temps, quiconque a passé la dernière décennie en France a probablement entendu des plaintes généralisées concernant la dégradation des services publics. Les médecins et les infirmières pointent du doigt les pénuries de personnel dans les hôpitaux publics ; les habitants des zones rurales protestent contre la fermeture de lignes de train ; les étudiants et les universitaires dénoncent le sous-financement des universités et des instituts de recherche, dont beaucoup peinent avec des infrastructures obsolètes.
Certains de ces problèmes ne sont pas purement financiers. Presque tous les pays sont confrontés à une pénurie de personnel soignant — un problème en France qui a été aggravé par des quotas d’admission en faculté de médecine, qui n’ont été levés qu’en 2020. Au cours des 25 dernières années, l’urbanisation est passée de 76 % à 82 %, ce qui rend plus coûteux par habitant le maintien des services dans les zones rurales en déclin. Cela soulève des questions difficiles sur l’équité et l’allocation des ressources. Les Français eux-mêmes sont de plus en plus conscients des inconvénients de la centralisation des décisions à Paris et soutiennent majoritairement une plus grande décentralisation.
Pourtant, dans un pays qui consacre à ces domaines une part de son budget plus importante que presque tout autre, il ne semble jamais y avoir assez d’argent. Contrairement à leurs homologues nordiques, la plupart des gens en France sont, à divers degrés, insatisfaits. Pendant ce temps, la dette et les déficits continuent de grimper à des niveaux insoutenables. Alors, que se passe-t-il vraiment ?
L’extrême droite blame l’immigration, avançant un récit fallacieux selon lequel les demandeurs d’asile mettent à rude épreuve les services publics. Le Premier ministre centriste, François Bayrou, propose de réduire les dépenses de tous les ministères pour économiser 44 milliards d’euros par an — allant même jusqu’à suggérer l’idée politiquement toxique de supprimer deux jours fériés. La gauche, plus raisonnablement, appelle à des impôts sur la fortune, bien que leurs propositions pourraient aussi affecter ceux qui gagnent plus de 20 584 euros par an et montrent peu de sympathie pour la charge administrative des travailleurs indépendants et des petites entreprises.
Au milieu de ce désaccord — qui pourrait renverser le gouvernement lorsque Bayrou affrontera un vote de confiance le 8 septembre — presque personne ne parle honnêtement du poste le plus important des dépenses discrétionnaires de la France : les 211 milliards d’euros dépensés chaque année pour subventionner les entreprises afin de créer des emplois. Le marché du travail français est notoirement rigide, avec des délais de préavis pouvant durer deux à trois mois. Cela a conduit à un chômage persistant, des salaires stagnants et un système qui dépense plus en subventions aux entreprises qu’en éducation.
Et si la France adoptait plutôt un modèle de « flexisécurité » à la danoise ? Combien de ces 211 milliards d’euros pourraient alors être réorientés vers la réduction du déficit et l’investissement dans la santé, l’éducation et les infrastructures d’énergie verte ? Permettez-moi d’être clair avant que l’on ne me comprenne mal. Tous les euros dépensés de cette façon ne méritent pas des critiques : le modèle français de forte implication de l’État dans l’économie est loin d’être erroné. C’est une des raisons pour lesquelles, malgré ses défis, la France possède ce qui pourrait être la seule économie véritablement complète d’Europe — couvrant tout, de l’agriculture à l’intelligence artificielle. En fait, cette approche devient chaque jour plus pertinente. La Chine a toujours fonctionné ainsi, et les États-Unis en font de plus en plus de même.
Le capitalisme a besoin de guidance. Pour ne donner qu’un exemple, sans orientation, nous nous retrouvons avec une situation chaotique où les régions rivalisent pour attirer des centres de données en abaissant les normes — des centres qui finissent par être alimentés par de nouvelles turbines à gaz et mettent à rude épreuve les ressources locales en eau. Au lieu de cela, la réglementation et les incitations pourraient orienter les investissements vers des endroits comme l’Islande, où l’abondante énergie géothermique pourrait les alimenter durablement, et les bénéfices pourraient être équitablement partagés.
Par le passé, une partie de cette orientation provenait d’accords et de traités internationaux, qui aidaient les petits pays à rester agiles et innovants. Mais aujourd’hui, nous vivons dans un monde où seules les nations — ou groupes de nations — suffisamment grandes peuvent protéger leurs intérêts externes tout en favorisant le dynamisme intérieur. Le défi de la France est une question de taille. Comme d’autres pays européens, elle est trop petite pour construire seule ces barrières protectrices — ce rôle doit incomber à l’UE. Du moins, il le devrait, si les dirigeants européens acceptent enfin que l’ancien ordre mondial ne reviendra pas.
L’UE, dans sa forme actuelle, ne peut prospérer dans un monde dominé par la puissance plutôt que par les règles — un monde où les États-Unis et la Chine mêlent géopolitique et économie de manière transparente et déploient leur influence à travers les domaines. Mais l’UE peut réussir si elle adopte une approche typiquement française. Il ne s’agit pas seulement que la France ait besoin d’un impôt sur la fortune — l’UE en a besoin aussi. Il ne s’agit pas seulement que l’agence spatiale française nécessite plus de financement — l’Agence spatiale européenne aussi. Il ne s’agit pas seulement que la France doive investir davantage dans l’énergie verte — toute l’UE a besoin d’indépendance énergétique grâce aux renouvelables.
L’ironie est que l’Europe n’ira pas dans cette direction à moins que la France ne soit assez forte pour montrer la voie. Pour que cela se produise, la France a besoin d’une économie prospère et d’une classe politique prête à s’engager dans une planification honnête et à long terme — pas de boucs émissaires, de gadgets ou de statu quo.
Alexander Hurst est chroniqueur pour Guardian Europe.
Foire Aux Questions
Bien sûr. Voici une liste de FAQ sur la dette et les subventions aux entreprises en France, formulées dans un ton naturel avec des réponses claires et concises.
Questions de niveau débutant
1 Qu’est-ce qu’une crise de la dette nationale ?
Une crise de la dette nationale survient lorsqu’un pays doit tant d’argent qu’il a du mal à le rembourser. Cela peut effrayer les prêteurs, obliger le pays à payer des taux d’intérêt plus élevés et entraîner des coupes sévères dans les dépenses publiques.
2 Que signifie « subventionner les entreprises » ?
Cela signifie que le gouvernement accorde aux entreprises des aides financières, des allègements fiscaux ou d’autres soutiens financiers. L’objectif est de les aider à se développer, à créer des emplois ou à être compétitives à l’international.
3 Si la France a tant de dette, pourquoi donne-t-elle de l’argent aux entreprises ? Cela n’aggrave-t-il pas le problème ?
C’est le cœur du débat. Le gouvernement argue que ces dépenses sont un investissement. Il estime que soutenir les entreprises maintenant conduira à une économie plus forte, plus d’emplois et des recettes fiscales plus élevées à l’avenir, ce qui aidera finalement à rembourser la dette.
4 Pouvez-vous donner un exemple simple de subvention aux entreprises en France ?
Un exemple courant est un crédit d’impôt. Une entreprise qui investit dans la recherche et le développement bénéficie d’une réduction sur les impôts qu’elle doit au gouvernement, économisant ainsi effectivement des millions d’euros.
Questions de niveau intermédiaire
5 Quels sont les principaux avantages de ces subventions ?
Création et préservation d’emplois : Empêche les entreprises de délocaliser usines et emplois vers d’autres pays.
Promotion de l’innovation : Encourage les entreprises à investir dans les technologies vertes, l’IA et d’autres secteurs à haute valeur ajoutée.
Compétitivité économique : Aide les entreprises françaises à rivaliser avec des concurrents de pays comme les États-Unis et la Chine qui bénéficient également d’un fort soutien étatique.
6 Quelles sont les critiques ou problèmes courants de cette approche ?
Inefficacité : Les critiques soutiennent que l’argent ne va pas toujours aux entreprises les plus productives, mais à celles ayant les meilleures connexions politiques.
Aide aux entreprises : C’est perçu comme des aides accordées à de grandes entreprises rentables qui n’en ont pas vraiment besoin.
Alourdissement de la dette : À court terme, cela augmente directement les dépenses publiques et alourdit la dette nationale.
7 Ces subventions sont-elles uniquement pour les grandes entreprises ?
Non, mais les grandes entreprises reçoivent souvent les sommes les plus importantes. La France a également de nombreux programmes destinés aux petites et moyennes entreprises et aux startups pour les aider à démarrer.